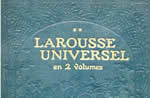Histoire

Les Landes
Les trois classes
On a dit que les habitants des landes forment trois classes distinctes : propriétaires, propriétaires-colons et métayers ou colons partiaires. Nous adoptons cette division, exacte pour les habitants des campagnes, les seuls dont nous nous occupions.
Le propriétaire y est ce qu'on le voit partout ailleurs, ce que l'on appelle un bon campagnard, commerçant par désœuvrement, industriel quelquefois, conseiller municipal, électeur, bon époux, bon père et le reste; mais ce qui le distingue, c'est une manière d'entendre la générosité et l'hospitalité dont les temps antiques seuls peuvent nous fournir l'exemple.
Le propriétaire-colon a tout cela, moins le vernis ; l'éducation lui fait défaut et le place dans une position spéciale qui, fortifiée par des habitudes séculaires, l'oblige à passer sa vie avec le simple métayer dont il adopte, du reste, le costume et le langage. Après tout, c'est là que le portent ses intérêts et ses goûts. C'est le métayer qu'il exploite, c'est du métayer qu'il tire brin à brin ces revenus qui, constamment entassés, finiraient par constituer de grosses fortunes, si Dieu n'y mettait ordre au moyen d'une fécondité toute patriarcale.
La troisième classe comprend le métayer, le paysan, le prolétaire du lieu. Ce n'est certes pas pour lui que se sont faites nos deux révolutions ; si ses droits à la liberté et à l'égalité ont été reconnus, il ne s'en doute guère, et paraît se croire encore au bon temps. Son seigneur à lui, c'est le propriétaire de la métairie qu'il cultive. Celui-ci est, autant que le permettent la civilisation et les lois actuelles, un seigneur au petit pied : il se fait appeler mestre, maître, reçoit au jour de l'an, à Pâques et à la Saint-Martin des redevances en produits des basses-cours et des jardins, et, s'il habite ses biens, exerce la plus grande influence jusqu'au sein des familles.
Cet asservissement moral n'est dû qu'au défaut d'éducation. Le paysan a conscience de son infériorité; ébloui par une distance qu'il ne peut apprécier, il n'ose lever les yeux vers un monde meilleur, et vit en lui-même insouciant et méfiant comme l'insecte dans sa coque. Il y a, du reste, quelquefois un bon côté dans cet état de chose : le propriétaire prend l'engagement moral de secourir son métayer, et dans les années de disette, celui-ci peut se trouver heureux d'avoir un maître.
Les saints et les fontaines
Ses mœurs sont un reflet de celles des peuples divers qui passèrent sur cette terre. Le Gaulois, le Romain, le Sarrasin et l'Anglais s'y trouvent confondus. Chrétien par le fond ou à peu près, le paysan landais est païen par la forme. Pour lui, les fées pourront bien revenir; les loups garous, les revenants et les sorciers n'ont jamais cessé d'exister. Il a bien quelque confiance en Dieu, mais non autant qu'en ces fontaines miraculeuses dont le paganisme nous a légué la tradition. Les dévotions et pèlerinages sont en grand honneur près de lui.
Peut-être, comme Élisabeth ou Sarah, déplorez-vous, madame, le malheur de vous voir sans postérité. Séchez vos pleurs, et espérez : pour l'avoir, cet enfant que tous vos vœux appellent, il vous reste bien peu à faire : rendez-vous à Bascons, devant la porte de Saint-Amand, faites jouer le verrou, une fois, deux fois, trois fois; et, maintenant, laissez faire; ce n'est pas plus difficile que cela.
L'enfant venu, il faut le nourrir. Vous reculez devant cette tâche. Est-ce le lait qui vous manque ? les grottes de Saint-Rémy vous en donneront de première qualité; venez sur les bords de la Douze, appliquez vos lèvres à l'extrémité de ces stalactites d'où découle une eau limpide, et vous m'en direz des nouvelles.
Mais peut-être, avant d'avoir un enfant, trouverez-vous logique de prendre un mari ?
Les saints et les fontaines ne se mêlent point seulement de faire les mariages; ils guérissent aussi tous les maux; à chacun le sien, car la liste en est longue. Quelques-unes de ces dévotions jouissent d'une grande renommée. Celle de Buglose réunit, il y a quelques années, une telle affluence, que les pèlerins, ne sachant où loger, forcèrent les portes de l'église, et, malgré le curé, couchèrent pèle-mêle dans le saint lieu.
Les fontaines de Sainte-Quitterie sont nombreuses et suivies. La plus remarquable de toute est, sans contredit, celle que l'on voit dans la crypte romaine de l'église du Mas d'Aire, l'un des rares monuments que nous ait légués la civilisation du quatrième siècle.
Dans le dessin que nous donnons ici, l'artiste a rendu exactement cette architecture grandiose et tout à fait caractéristique. Sur le premier plan, une balustrade en pierre de taille entoure l'espèce de puits au fond duquel se trouve la fontaine miraculeuse; on y descend par quelques marches. À droite, un cénotaphe en marbre blanc sur lequel un artiste de l'époque a reproduit avec talent quelques scènes principales de l'Ancien et du Nouveau-Testament; ce marbre fut sans doute l'enveloppe extérieure d'un tombeau situé dans le fond de la crypte et qui passe pour avoir contenu les restes de la vierge martyre. D'autres tombeaux sont disséminés dans l'étendue de la crypte. L'abside a été recouverte d'une peinture à fresque d'une exécution naïve, où des écussons de chevaliers se trouvent mêlés aux scènes de l'Évangile. Nous regrettons d'avoir à déplorer ici l'état de malpropreté dans lequel on laisse un monument de cette importance. La poussière, l'humidité, les herbes parasites ont envahi ce berceau de la religion dans la Novempopulanie, ces voûtes sous lesquelles la parole de Dieu retentissait pour les catéchumènes, et bientôt on verra se changer en cloaque infect ce sol que baigna sans doute le sang des martyrs. Puissent des voix plus puissantes que la nôtre s'élever en faveur de la religion et de l'art, et faire rougir de leur négligence un clergé pour lequel de pareils souvenirs ne sont plus sacrés, un gouvernement qui livre à l'oubli, à la destruction peut-être l'un des restes les plus précieux de la civilisation antique !
Le paysan
Le paysan vit essentiellement de la vie de famille et pratique l'association avec une abnégation remarquable. Le commandement est généralement dévolu au plus ancien et à sa femme; leurs conseils sont écoutés, leurs ordres exécutés avec une obéissance passive. C'est la famille patriarcale, avec cette différence que le patriarche était un roi et que le tinel est une espèce de république où, comme dans celle des abeilles, sous les ordres du chef, chacun travaille pour la communauté.
La nourriture du paysan est fort simple; à la volaille, aux porcs qu'il élève, aux bêtes qu'il retranche de son troupeau, aux produits des jardins, il ajoute un pain de seigle assez noir, et cette nourriture toute spéciale que l'on nomme escauton ou cruchade.
Ce met n'est point le brouet de Lacédémone, comme l'ont avancé des voyageurs fantasques; de même que le pain qu'il ne remplace qu'en partie, il est composé de farine, d'eau et de sel; mais la préparation lui donne plus d'analogie avec la polenta des Italiens et même avec le couscoussous des Arabes; la saveur n'en est pas désagréable, l'habitude le fait trouver supérieur à toutes les métures, et le plus sybarite de nos rois, Louis XVIII, a daigné le trouver délicieux. Malheureusement, le paysan landais n'a pas à sa disposition le cuisinier du monarque !
Le costume du paysan landais est à peu de chose près celui qui se porte généralement entre les Pyrénées et la Garonne, pour les hommes du moins. Quelques vieillards ont conservés la culotte et la guêtre; les autres ont adopté le pantalon, le gilet droit et la veste, spencer non pincé à la taille; ai lieu de chapeau, le béret dit béarnais. La couleur marron et le bleu sont préférés. En hiver, les bergers endossent un paletot sans manches, formé d'une peau de mouton et réellement imperméable. Dans le Maransin, ce vêtement est remplacé par une dalmatique, ailleurs par la cape, vrai burnous arabe, s'il n'était agrafé sur le devant au lieu d'être cousu.
Les costumes des femmes sont beaucoup plus variés. Chaque localité apporte sa différence. Comme coiffure, la capulette est fort répandue; on retrouvera facilement dans celles que M. Longa a reproduites une ressemblance avec quelques coiffures d'Italie. Dans l'intérieur, on porte des chapeaux de paille, et surtout, pour se garantir du soleil, les chapeau de feutre noir à la catalane. C'est l'unique coiffure des femmes de la côte, qui l'ornent presque toujours de quelques immortelles rouges.

Les habitations ne sont certes pas luxueuses et appellent de nombreuses améliorations; mais ce ne sont ni des cabanes couvertes de chaume, ni des tentes, comme on n'a pas craint de le dire. En somme, elles sont moins misérables (triste consolation !) que celles des paysans d'une grande partie de la France.
Le mariage
La richesse de la famille landaise consiste dans le travail, et conséquemment dans le nombre de ses membres. Aussi le mariage n'y a-t-il point perdu son but, comme dans nos sociétés plus civilisées, où la survenance d'enfants est un fléau. Le paysan landais ne connaît pas le célibat, et contracte le plus souvent des unions précoces. Le choix du jeune homme se porte de préférence sur celle qui jouit d'une réputation bien établie de bonne ménagère et d'une constitution qui laisse espérer un grand nombre d'enfants. La déception de cette espérance est le plus vif chagrin qui puisse l'atteindre.
Par suite d'un usage qu'une intéressante partie de nos populations civilisées accueillerait sans doute avec enthousiasme, on laisse aux jeunes gens le soin de se choisir et de s'accorder. La demande est faite par le prétendant ou des messagers; ceux-ci sont priés à un repas auxquels les hommes seuls prennent part; c'est la future qui le sert, comme au temps du bon Homère, où les filles de rois servaient leurs hôtes. Le consentement est donné à la fin du repas, à moins que la jeune fille n'ait manifesté une intention défavorable, en plaçant devant le prétendant ou ses messagers un plat de noix sèches, et lui marquant ainsi que son espérance est vaine. L'usage commence à se perdre, mais l'expression reste, et donner les noix, pour dire refuser en mariage, est passée en proverbe.
On ne se marie point sans trousseau ; la jeune Landaise en apporte un à son mari, avec un lit et une armoire. Quand il y manque quelque chose, la jeune fille peut, la quenouille au côté, se mettre en quête et demander aux voisins le complément. Cette démarche, quoique rare, n'a aucun caractère déshonorant.
Le contrat passé, car il en faut un, et sous le régime dotal, s'il vous plaît, avec communauté d'acquêts, les préparatifs de la noce commencent. D'abord, les amies de l'épousée, les donzelles, viennent coudre son lit et l'étourdir de leurs chansons. L'époux choisit aussi parmi les jeunes gens un certain nombre de donzelons destinés à lui faire un cortège d'honneur. Enfin les invitations se font par des cassecans choisis à cet effet.
Le cassecan
Pour comprendre le sens de cette désignation ironique (chasse-chiens), il est nécessaire de savoir qu'autrefois les cassecans avaient pouvoir, quand la noce était terminée, de mettre à la porte les conviés. Ce soir-là, un oignon mis à la broche, en souvenir sans doute de la famine d'Egypte, est arrosé d'eau limpide par un enfant, dont le front frais tondu respirait la candeur, avertissait les invités que les provisions étaient achevées, et les cassecans, armés de balais, insignes de leurs fonctions toutes domestiques, engageaient les hommes seulement à se retirer.
On choisit pour ces fonctions des hommes robustes et bien stylés, bon pied, bon œil et bonne dent, bonne dent surtout. Revêtus de leurs plus beaux habits, la boutonnière chargée d'un nombre prodigieux de petits rubans destinés aux conviés, ils vont faire les invitations en chantant à tue-tête. Dans les maisons jouissant d'une bonne renommée, renommée de cuisine, bien entendu, le cassecan mange, partout il boit, et le nombre de ces repas peut se renouveler assez de fois pour effrayer le calcul. Cette mission est considérée comme fort honorable, et ceux qui en ont l'habitude ne connaissent pas de fête comparable à celle-là.
| Le mariage est toujours célébré le mardi. La veille au soir, comme chez les Arabes, a lieu le départ du lit de la mariée. Le lit, l'armoire, le trousseau, entassés sur la charrette de la famille, forment une pyramide, au haut de laquelle, comme une reine sur un trône, se place la marraine tenant à la main la quenouille chargée de brins de chanvre et recouverte d'un magnifique papier peint et de rubans de toutes les couleurs. Les bœufs portent des housses blanches ornées, ainsi que leurs cornes, de bouquets et de rubans, et il n'est pas jusqu'au bouvier qui ne pare son béret et son aiguillon de ces insignes de fête. La voiture s'éloigne lentement, et longtemps les donzelles la poursuivent de leurs chansons. Le plus souvent, quelques-unes grimpent sur l'édifice mobile et, s'échelonnant à diverses hauteurs, ressemblent de loin à ces statues allégoriques que nos pères aimaient à voir adossées à leurs monuments. Comme partout, la toilette de la mariée est une grande affaire ; les donzelles en sont spécialement chargées. Cette cérémonie, qu'accompagne la grâce folâtre que les jeunes filles apportent à toutes leurs fêtes, est célébrée par des chants. La pose de la couronne, et surtout la fin de la toilette, donnent lieu à des couplets pleins d'une poésie sauvage, mais ornés d'une originalité et d'une grâce native que la traduction ne saurait rendre : |
|
|
Nous avons une belle épousée, Si sa taille n'est aussi élancée Si les jeunes filles en rougissant |
| Ces couplets, auxquels le patois harmonieux du pays prête une grâce toute particulière, sont chantés à pleine voix tantôt sur un air à trois temps empreint d'une gaieté douce, tantôt sur l'air à deux temps que nous reproduisons ici. | ||
|
Nous extrayons quelques couplets du chant de départ : Pourquoi sur ton front, mon épousée, Le rossignol le dit dans les buissons, Pour faire un berceau sur ta tête, |
En quittant la maison paternelle, on chante les adieux de l'épousée :
|
| C'est à cheval le plus souvent que l'on se rend à l'église ; le parrain sert de chevalier à l'épousée, et ne la quitte qu'au pied des autels. Les donzelles, portées en croupe par les donzelons, doivent chanter la nobi, l'épousée, sans interruption. | |
|
|
Sous le porche, l'époux passe autour de la taille de la mariée un ruban de satin rose, emblème un peu païen de la pudeur conjugale, souvenir de la ceinture de Vénus, que lui seul aurait le droit de délier.
|
|
Ces fêtes, toujours nombreuses, réunissent quelquefois plusieurs centaines d'invités. Une noce, pour être complète, doit durer trois jours après la bénédiction nuptiale, et peut commencer deux jours avant. Certains de ces festins donnés par la classe haute et moyenne pourraient, sans désavantage, être cités après les noces de Gamaches.
Tout le temps qui n'est pas employé à la bonne chère est consacré à la danse ou au jeu. Chez les paysans, pour lesquels la musette n'a point perdu son charme, le bal est bien vite organisé. C'est une danse grave et mesurée, un rondeau qui peut devenir immense, animé et plein de gracieusetés pour celui qui mène, presque insensible pour ceux qui sont placés à l'autre extrémité de la chaîne. Posté au milieu de cet anneau rompu, le joueur de musette, sans perdre un seul pas de la danse, saute aussi haut que les autres, tantôt penché vers le côté gauche sur lequel est appuyé l'instrument qu'il anime de son souffle, tantôt relevant extatiquement la tête, tandis que la musette, sous la pression de son bras, poursuit seule son refrain.
| La dernière cérémonie que les époux aient à subir est celle de la roste ou rôtie. Au moment où ils viennent d'entrer dans la chambre nuptiale, on les oblige à goûter d'une rôtie composée d'ingrédients hétérogènes. C'est à une pensée philosophique qu'est dû l'usage de cette rôtie amère, la même pensée qui a inspiré à l'Eglise de terminer les saturnales du Carnaval en couvrant de cendres le front des fidèles, en commémoration des cendres dont les peuples antiques se couvraient la tête aux jours de leur deuil. Le mélange repoussant dont la rôtie est imprégnée indique les amertumes qui doivent tremper notre pain de chaque jour ; et, cependant, le vin et les épices qui en forment la base ne sont-ils pas le viatique fortifiant dont se munissait le pèlerin avant le voyage ? Aujourd'hui cet usage est prêt à disparaître, comme tant d'autres; là où il subsiste encore, il est si singulièrement adouci, peut-être dans la crainte de troubler par un souvenir importun les moments de bonheur, déjà si rares, dont il est donné à l'homme de jouir. |
L'ouvrier
Malgré quelques points de contact, l'ouvrier se distingue essentiellement du paysan, et il importe de ne pas les confondre. L'artisan est un être mixte : il tient au paysan par le costume, le langage et quelques habitudes; au bourgeois par le caractère et le sentiment de valeur. Nous le croyons préférable à l'ouvrier de Paris, il est plus sobre et plus moral. Le costume des femmes ne manque pas de grâce. Rarement le voyageur passe sans admirer ces tailles, petites mais bien prises, qui suivent les ondulations d'une démarche preste et légère, et ces cheveux d'un noir plus chatoyant que celui du satin, sous le madras qui les couvre à peine.
Fidèle aux anciens principes, l'artisan conserve dans leur pureté les idées domestiques, le respect dû à l'âge et tout ce qui constitue les bonnes relations de la famille.
|
|
... Le lecteur français veut être respecté. Il est vrai que ces couplets n'étant destinés ni à des Français, ni à des lecteurs, mais à des auditeurs gascons, les règles peuvent être mises de côté et chacun s'en donner à cœur joie. |
Marchés et foires
Quoi qu'il fasse peu d'affaires, le Landais se rend régulièrement aux marchés et aux foires. La plus fameuse de celles-ci est sans contre-dit celle de Labouheyre. Cette localité, dont le nom signifie la bonne foire, est située au milieu des grandes landes. L'histoire nous apprend qu'à la place qu'occupent les magnifiques chênes sous lesquels se tient la foire, s'élevait jadis une ville fortifiée, Herbefaverie, où fut transporté l'évêché de Dax au commencement du onzième siècle. Cette foire, dont la durée réelle dépasse cinq jours, est le rendez-vous des commerçants des toutes les Landes, tant de celles comprises dans le département de ce nom, que celles non moins étendues qui font partie du département de la Gironde. Les produits du pays en sont l'objet principal. O y voit, auprès des bœufs indigènes, ordinairement assez chétifs, la grande race garonnaise, et cette admirable variété dite de Bazas à laquelle la beauté de ses formes nerveuses et la belle couleur bistrée de sa robe assurent une incontestable prééminence.
Les chevaux y font aussi l'objet de nombreuses transactions. La ace du pays, la race landaise y est négligée ; la petitesse de sa taille lui fait préférer la race navarrine, qui ne la vaut pas sous bien d'autres rapports. Car le cheval landais est un animal plein de mérites et dont une incroyable incurie a seule, jusqu'à ce jour, empêché de tirer un parti plus avantageux.
La finesse de ses formes lui a valu d'être comparé au cheval arabe, avec lequel des connaisseurs, et M. Alexandre Dumas, ont cru lui reconnaître des liens de parenté. Il a la jambe effilée, la tête fière, l'œil sauvage et la crinière au vent ; il est sobre, régulier dans l'allure qu'il a prise dès sa jeunesse, infatigable au delà de tout ce qu'on pourrait attendre. Il a le germe des meilleures qualités; il ne lui manque en un mot que des soins mieux entendus pour reprendre, dans la race chevaline, le rang honorable qui lui appartient.
L'agriculture
La différence qui existe entre les deux parties du département des Landes que l'Adour sépare, entre la Chalosse et les Landes proprement dites, ne tient pas seulement à la constitution même du sol, mais encore aux procédés agricoles. Le dernier de ces pays est certainement arriéré ; toute une révolution doit y être faite. Depuis de longues années, des esprits sérieux et préparés par l'étude ont abordé cette question. Presque tous les essais ont été malheureux ; peut-être parce qu'on a employé des méthodes, excellentes ailleurs, mais incompatibles à la nature d'un sol qui veut être traité d'une façon toute spéciale. La majorité de la population aime mieux rejeter la faute sur une stérilité incurable et se condamner ainsi à une éternelle immobilité. Les obstacles, il est vrai, sont énormes : la maigreur des terres que l'on travaille sans relâche, la rareté de l'eau, et par suite de prairies et d'engrais, le manque de bras et un mode vicieux de fermage, sont autant de barrières opposées au progrès. Cependant, dans les derniers temps, des améliorations ont été obtenues ; chacun les connaît, et ce devrait être un encouragement à de nouveaux essais ; l'importation du maïs et du froment est, en beaucoup d'endroits, d'une date toute récente, et nous voyons chaque jour s'étendre la culture de la vigne.
Les champs produisent deux récoltes : l'une en été, l'autre en automne. La première consiste dans le seigle, le froment n'existant guère qu'à l'état d'exception ; la deuxième est plus variée : elle comprend le maïs, le grand et le petit millet, et divers autres menus produits. On peut encore compter le vin, qui s'élève, en quelques localités, au-dessus du médiocre.
Les prairies, malheureusement assez rares, ne permettent pas de donner à l'élève des bestiaux tout le développement désirable. Les bêtes ovines ne vivent guère que des maigres herbes parsemées dans la lande. Les bœufs y sont nourris de la tige du gros millet et des larges feuilles du maïs, que certains savants ont confondues avec celles du roseau.
En somme, un seul végétal se reproduit dans toute l'étendue des landes avec cette vigueur de végétation qui prouve la parfaite convenance du sol et du climat; un seul rend d'abondants produits en récompense des soins dont il est l'objet : c'est le pin. Nous n'en parlerons pas de nouveau, nous l'avons suffisamment décrit dans notre précédent article.
Illustration, 7 août 1847